En résonance à l’extrait proposé hier soir. Un article que j’avais fait paraître il y a quelques années…
Vous ne voulez pas partir loin cet été ? La Côte d’Albâtre vous tend les bras, et plus encore un des plus beaux villages de France : ce fameux Veules-les-Roses. Petit tour de cet endroit à l’histoire étonnante !
Mille excuses pour la mise en page un peu hétéroclite, cet article vient de mon ancien blog Skynet.
∴
C’est un petit village côtier du pays de Caux. Traversé par le plus court fleuve de France (1100m) qui lui assura une certaine prospérité grâce aux moulins à huile de colza : Veules-les-Roses.


Avec le chemin de fer depuis Paris et la découverte des plaisirs marins, le village se transforme après 1850 en station balnéaire à la mode, d’autant que Victor Hugo et ses amis de théâtre s’en sont entiché. Le grand homme se fait même bienfaiteur auprès des enfants.



Veules-les-Roses succombe alors à la « Hugomania ». Il y a notamment la promenade, la villa, un grand monument portant son nom. Aujourd’hui, Michel Bussi situe la première nouvelle de son recueil « T’en souviens-tu, mon Anaïs? » dans ce vrai déferlement.
Reconnu parmi « Les plus beaux villages de France », Veules-les-Roses sait mettre en avant tous ses charmes : la plage, les falaises, les fleurs omniprésentes et des canaux qui la font surnommer « la Venise de Normandie »…




Mais Veules-les-Roses a connu une autre grande aventure au XIXème siècle, redécouverte il y a peu : les Russes y débarquèrent. Peintres Ambulants et Académiques s’y retrouvèrent pour une double aventure picturale proche du mouvement impressionniste.
Qui sont-ils?
Les Indépendants Russes Ambulants
Rappelons-nous qu’en France aux alentours des années 1860, le mouvement des peintres impressionnistes avait eu bien du mal à percer en marge du Salon officiel. Il avait fallu le coup de pouce de Napoléon III lui-même pour créer le fameux Salon des Refusés où exposèrent notamment en 1863 Pissarro, Manet, Fantin-Latour, Jonkind puis en 1864, Monet, Renoir Bazille, Sisley…
Exactement à la même époque en Russie, le peintre Nicolaï Lanskoï et treize de ses camarades avaient refusé de traiter le sujet du concours final de l’Académie de Saint-Pétersbourg qu’ils jugeaient trop académique. Ils renonçaient ainsi à la possibilité du prix et de commandes officielles. Pour assurer leur indépendance économique et leur promotion, ces peintres fondent l’Artel, société coopérative des peintres indépendants. Leurs œuvres sont bien accueillies par la société russe, notamment par le riche marchand collectionneur Trétiakov, et la plupart connaîtront alors la réussite économique et sociale.
Les Indépendants Russes partagent avec leurs camarades français le désir de faire sortir la peinture de l’académisme et de l’atelier pour cueillir en plein air, sur de petits formats, le motif vrai, vivant et naturel ; ce que permettent les nouvelles peintures à l’huile, ainsi que le développement des chemins de fer. Ils reviendront progressivement à des valeurs proprement russes, plutôt qu’occidentales.
Pour diffuser leur production, ils fondent une Société des Expositions Itinérantes, ou Ambulantes, dont la vocation est d’organiser une rétrospective de leur production annuelle, qui tourne dans les principales villes de l’Empire de Russie. Cette organisation se maintiendra jusqu’après la révolution bolchevique, et concernera des millions de visiteurs au total. Les peintres prendront alors le nom d’Ambulants ou Itinérants.
Les Russes académiques
De leur côté, les Peintres Académiques qui suivaient les études supérieures de l’académie de Saint-Pétersbourg pouvaient, s’ils remportaient un premier prix et une grande médaille d’or (six par an), utiliser une bourse d’étude pour 5 ans de perfectionnement à l’étranger. Ils se rendaient le plus souvent à Rome. À partir des années 1860, ils choisirent plutôt Paris devenue Ville Lumière et siège d’une grande communauté russe.
En 1868, Eugène Isabey, de l’École de Barbizon et spécialiste de marines, conseille à ses étudiants russes d’aller passer leurs vacances d’été au bord de la mer, en Normandie. Plus précisément dans une petite station devenue la coqueluche des artistes dramatiques parisiens dont Victor Hugo: Veules-les- Roses…
Le premier à s’y rendre est Bogolioubov. Enthousiaste, il entraîne quatre de ses camarades.
Ce sera le début d’une véritable école russe de plein-air où vont se retrouver peintres Académiques et Ambulants : Polenov, Harlamov, Savitski, Goun, Repine, Levitan … tous venus travailler en Normandie jusqu’en 1914.
Quelques peintres et leurs chefs-d’oeuvre normands
Alexis Bogolioubov (1824-1896)
 Il est le premier à découvrir Veules en 1857, il est enthousiasmé, et la Normandie devient sa région préférée. En 1870 il fonde et devient président de l’association d’entraide et de bienfaisance des jeunes peintres boursiers russes. A partir de 1874, il conduit ses propres protégés à Veules, c’est ainsi qu’une quinzaine de jeunes peintres partirent découvrir la méthode privilégiant le plein air, la nature et les scènes de la vie quotidienne.
Il est le premier à découvrir Veules en 1857, il est enthousiasmé, et la Normandie devient sa région préférée. En 1870 il fonde et devient président de l’association d’entraide et de bienfaisance des jeunes peintres boursiers russes. A partir de 1874, il conduit ses propres protégés à Veules, c’est ainsi qu’une quinzaine de jeunes peintres partirent découvrir la méthode privilégiant le plein air, la nature et les scènes de la vie quotidienne.



Vassili Polenov (1844-1927)
 Sa carrière est fortement influencée par le séjour organisé par Bogolioubov. Se croyant d’abord peintre d’histoire, il découvre à Veules sa vraie vocation de peintre de paysages.
Sa carrière est fortement influencée par le séjour organisé par Bogolioubov. Se croyant d’abord peintre d’histoire, il découvre à Veules sa vraie vocation de peintre de paysages.
Ilya Repine (1844-1930)
Excellent dans tous les genres, Repine déclare dans sa correspondance avoir reçu à Veules en 1874 « sa troisième leçon de peinture » après l’Ukraine et la Volga…


Alexis Kharlamov (1842-1925)
Portraitiste de formation, Kharlamov possédera une résidence secondaire à Veules, la Sauvagère. La commune de Veules détient un original de sa main, exposé salle des mariages : Chaumière dans la cavée du Renard, à Veules.


Toutes les oeuvres de cette époque furent ensuite dispersées en Russie. Et c’est au hasard de voyages individuels que certains de ces tableaux ont été redécouverts. Tout un travail de recherche est alors initié pour les localiser, les inventorier. Depuis quelques années, des livres et des expositions cherchent à reconstituer cette étonnante aventure.
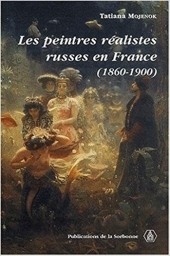


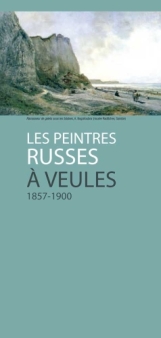
Étonnant!
Si les Russes s’installèrent à Veules-les-Roses, à Giverny Monet fut entouré par des peintres impressionnistes américains dont certains s’installèrent définitivement et formèrent une colonie à l’inspiration très originale basée sur la vie quotidienne et la place de la femme. L’aventure s’acheva également avec la Première Guerre mondiale.
Pour en revenir à Veules-les-Roses dans une époque plus proche de nous :
 En 1940, malgré l’absence de port, Veules vit s’embarquer 3000 soldats britanniques et français qui avaient résisté à l’invasion de la France par les Allemands. Beaucoup ne durent leur salut qu’en descendant les falaises d’amont avec des moyens de fortune. En suivit une bataille sanglante, son front de mer fut détruit ainsi que son casino et ses villas (35 maisons sont anéanties le même jour). La « Kommandantur » s’installa à Veules pendant quatre ans, pillant et saccageant d’autres maisons.
En 1940, malgré l’absence de port, Veules vit s’embarquer 3000 soldats britanniques et français qui avaient résisté à l’invasion de la France par les Allemands. Beaucoup ne durent leur salut qu’en descendant les falaises d’amont avec des moyens de fortune. En suivit une bataille sanglante, son front de mer fut détruit ainsi que son casino et ses villas (35 maisons sont anéanties le même jour). La « Kommandantur » s’installa à Veules pendant quatre ans, pillant et saccageant d’autres maisons.
Aujourd’hui, juste l’envie de les découvrir, elle et son riche passé!















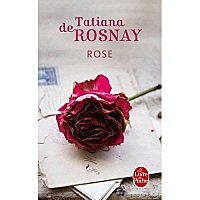
 Patrice de Moncan, incorrigible amoureux de Paris, s’est pris de passion pour l’oeuvre de Marville. Dans une émission de Michel Field (plus visible malheureusement), il explique combien le Second Empire a eu mauvaise presse. Lui en avait la passion, une passion connue de ceux qui, ayant hérité de témoignages de cette époque et connaissant leur peu de valeur marchande, se sont tournés vers lui pour s’en débarrasser, dont L’Album du Vieux-Paris édité par Marville en 1865. Celui-ci était alors un des nombreux photographes de la Ville de Paris, sans gloire particulière de son vivant. Moncan lui a tout d’abord dédié deux expositions et ensuite a fait paraître un livre « Paris avant/après » dans lequel il met en parallèle les clichés de Marville et les siens, puisqu’il a cherché à retrouver les mêmes endroits et à les photographier en 2010 sous le même angle. C’est passionnant et cela réhabilite assez souvent l’oeuvre d’Haussmann.
Patrice de Moncan, incorrigible amoureux de Paris, s’est pris de passion pour l’oeuvre de Marville. Dans une émission de Michel Field (plus visible malheureusement), il explique combien le Second Empire a eu mauvaise presse. Lui en avait la passion, une passion connue de ceux qui, ayant hérité de témoignages de cette époque et connaissant leur peu de valeur marchande, se sont tournés vers lui pour s’en débarrasser, dont L’Album du Vieux-Paris édité par Marville en 1865. Celui-ci était alors un des nombreux photographes de la Ville de Paris, sans gloire particulière de son vivant. Moncan lui a tout d’abord dédié deux expositions et ensuite a fait paraître un livre « Paris avant/après » dans lequel il met en parallèle les clichés de Marville et les siens, puisqu’il a cherché à retrouver les mêmes endroits et à les photographier en 2010 sous le même angle. C’est passionnant et cela réhabilite assez souvent l’oeuvre d’Haussmann.






























