Se montrer
Paraître et être vu
Au début du XVIIIème siècle, se montrer est une discipline à part entière, une forme de civilité, vantée à la fois par la littérature, les traités de civilité et les guides de promenade qui donnent maints conseils de maintien et de postures des corps. Paraître, enjeu majeur, s’apprend, et la promenade obéit à des contraintes. Duchesses et marquis sont très informés de ce dispositif particulier. Visibles, reconnaissables, susceptibles d’être, à ciel ouvert, flattés et honorés, les voici à découvert plutôt que cachés dans leur hôtel ou leur carrosse toutes vitres fermées. Ils ne détestent pas que les gens du peuple touchent le tissu de leurs habits ou les suivent en imitant leurs belles manières… (…)
À chaque promenade son public
Pour chacune, l’idée de nature et son agencement sont fondamentaux. Les plans montrent des allées rectilignes, bordées d’arbres, suivant des axes précis. Ces allées sont souvent divisées en trois voies, et les contre-allées plutôt réservées à l’usage des carrosses et des chevaux, mais les promeneurs à pied peuvent s’y rendre, même si ce n’est pas sans risque étant donné la vitesse des cavaliers.
On dit le jardin des Tuileries le plus beau de tous, en raison des sa majestueuse allée centrale ; cette promenade favorise à merveille le « paraître et être vu » grâce à cette grande allée qui relie sur 300 mètres deux agréables bassins.
La foule est telle que des portiers régulent le flux et « refoulent les gens de basse condition » ce qui provoque plusieurs indignations et rixes. Sur cette pression, le jardin sera ouvert à toutes et à tous : la « promenade du paraître » côtoiera les boutiquiers, vendeurs, débiteurs de boissons, marchands de colifichets ou de gâteaux secs nommés « oublies ». (…)
Imiter les grands
Un des plaisirs des Parisiens, et notamment des maîtres artisans et de leurs femmes, est de s’échapper de l’atelier pour rejoindre les promenades : les Tuileries, le Palais-Royal, et plus tard dans le siècle, les Champs-Élysées. C’est là, dans les allées, entre les bosquets, qu’on peut avec une élégance se voulant imiter celles des grands, déambuler entre les arbres, s’arrêter pour manger, acheter aux nombreuses marchandes et vendeuses beaucoup de rafraîchissements et de gâteaux. Un gâterie attire énormément de monde issu de la moyenne bourgeoisie : aller souper pour goûter le goujon, se régaler d’huîtres et boire du vin musqué. Ce geste est une manière de se « mettre en relief », de faire partie de ceux qu’on regarde. Certes, jamais on ne ressemblera à une duchesse ou à une marquise, mais, du moins, habillée par une marchande de mode, on aura énormément de bonheur à vaguement imiter les grands, et à consommer ce qu’ils aiment aussi. Il faut suivre la mode : plus le siècle avance, plus la bourgeoisie s’empare de beaux atours et cherche à avoir une vraie présence dans les lieux de promenade où sont permis ces agapes.
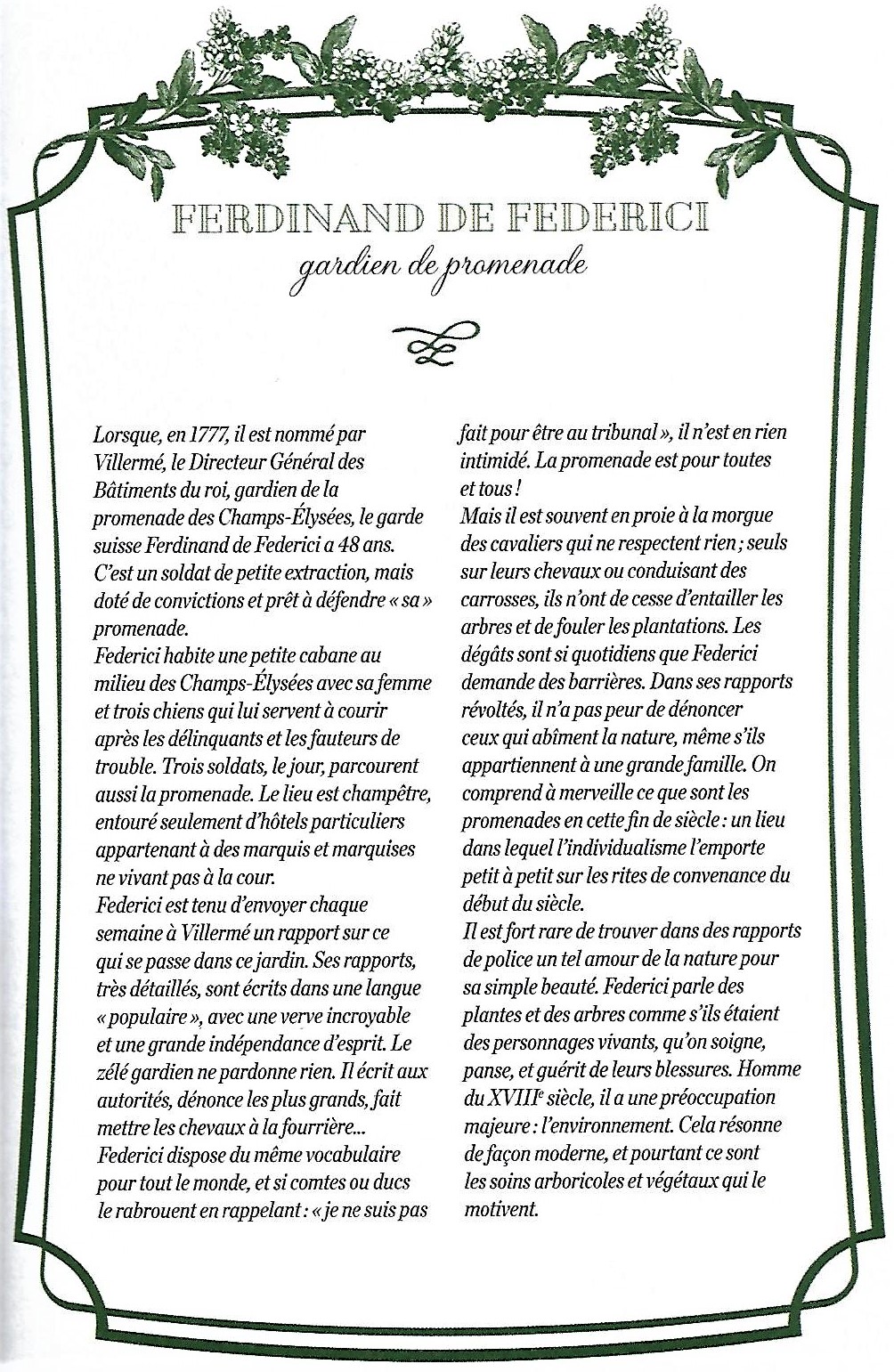
Les bonnes moeurs mises à mal
Les corps renseignent beaucoup sur ce qui se passe dans le jardin. Sensuels, s’exprimant par le geste, la voix ou le cri, ils déversent sur la promenade une sorte de joie entraînée par l’ivresse, si fréquente au XVIIIème siècle. La vie est là, tumultueuse ; les esprits et les corps jouent avec le plaisir. (…)
Révoltes d’écoliers, duels interdits, rixes et batteries, disputes entre petits marchands, atteintes au respect des plus grands… Les gardiens de promenade ont fort à faire.
Arlettre FARGE, Paris au siècle des Lumières







Un commentaire sur “Au fil des mots(53): « promenade »”