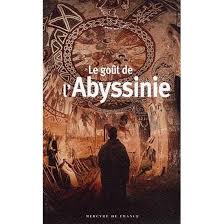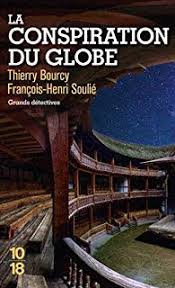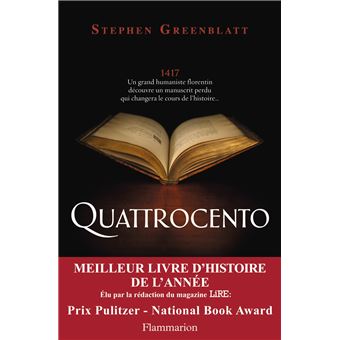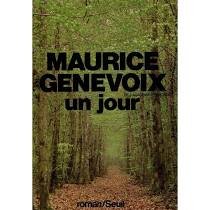LE PÈRE NOËL- décembre 1991
Voici venu le temps des rétrospectives et des palmarès, le classement périssable des gens et des événements qui nous ont marqués en ces temps de tourmente, le rituel de l’enterrement médiatique de l’année qui s’achève. Et quelle année ! Que de décombres, de tâtonnements et d’incertitudes !
Heureusement, il y a le Père Noël. Il nous revient, immuable et bonhomme avec son attirail pour nous faire communier pendant quelques jours au nom des enfants et des joies familiales sur l’autel de la consommation. Il y aura dans sa hotte cette année plus de game boys que de chevaux de bois, mais le Père Noël, lui, sera toujours en rouge, avec sa houppelande liserée de blanc, et sa barbe, assortie de gros sourcils cotonneux, s’il fait bien les choses. On a oublié, tant son apparence est aujourd’hui la même à la ville et à la campagne, dans les neiges du Nord ou les savanes d’Afrique, tiré par les rennes ou par des antilopes, on a oublié qu’il nous apparut d’abord revêtu d’une peau d’ours, tout velu, puis qu’il ressembla à un Esquimau, avant de trouver son habit rouge où se fondent, dans la couleur et dans la forme, le religieux et le païen, le mage et le mendiant, le sang et le feu, la joie et l’enfer. On a tout simplement oublié, tant il nous rassure, que le Père Noël a une histoire. Une histoire inattendue qui compte bien peu d’experts, même si en France nous avons le meilleur en la personne de Jean-Claude Baudot, collectionneur, hagiographe, infatigable organisateur de rallyes et d’expositions toujours consacrés au Père Noël.
D’abord, le Père Noël n’est pas si vieux – à peine plus que Monsieur Pinay. Et il est américain. Il est né, presque officiellement, en 1822, dans l’État de New York, sous la plume d’un pasteur, qui était professeur de théologie et qui s’appelait Clément Clarke Moore. Il écrivit pour ses enfants un poème qu’aujourd’hui encore tous les Américains connaissent par coeur, Nuit de Noël. C’est ainsi que Saint Nicolas, introduit au Nouveau Monde par les immigrés hollandais et allemands, perd sa mitre, son âne et son allure d’évêque pour se transformer en vieux lutin tout dodu et rieur bondissant d’une cheminée. Un autre Américain, un dessinateur, Thomas Nast, lui trouva en 1863 son apparence qui devint universelle. Le Père Noël, qu’on appelle Santa Klaus aux États-Unis, débarque en France, comme d’autres Américains, pendant la Deuxième Guerre mondiale, et c’est le plan Marshall qui avec le chewing-gum, le Coca-Cola et la société de consommation, l’installe définitivement dans nos habitudes. Comment, s’indigneront les chauvins et les puristes du patrimoine, nous avions un bonhomme Noël dans la Bresse et le Mâconnais, nous avions un père Janvier, une tante Ari en Franche-Comté, et nous avions le saint Nicolas que les Lorrains et les Alsaciens chassés par la guerre de 70 amenèrent à Paris avec le sapin de Noël. Il y avait dans la tradition chrétienne nombre de saints généreux et donateurs, Martin, Thomas, Lucie, Catherine ou Barbe. Ils avaient succédé aux dieux païens qui en des temps plus reculés savaient déjà reconnaître les enfants sages, et qui s’appelaient Odin dans le Nord ou Strenia, déesse romaine, qui patronnait les cadeaux qu’n s’échangeait pendant les Saturnales pour célébrer le solstice d’hiver. Plus ancien encore, il y avait Gargan, le fils du dieu celte Bel, qui portait une hotte. Il y en eut tant et tant, des dieux et des mages, des saints et des vierges, des diables et des sorcières, des fées et des croquemitaines, accumulés dans nos contes d’enfants, enfouis dans nos mémoires. Ils appartenaient toujours à l’ordre du bien et du mal où alternaient récompenses et punitions, cadeaux et coups de bâton, rêves et cauchemars, frissons et frayeurs, jusqu’à saint Nicolas toujours flanqué du père Fouettard, son âme damnée. Le Père Noël qui leur succède tous, descend toujours par la cheminée, symbole de purification, mais il a bien perdu de son rôle rédempteur.
Saint Nicolas, évêque d’Asie Mineure au Vème siècle chemina longtemps sur son âne, de génération en génération jusqu’à ce qu’on entreprît, en terre protestante puis en milieu laïque, de le soustraire à l’emprise religieuse. Le Père Noël, son fils naturel, apparut au clergé comme tellement impie qu’on le brûla à Dijon en 1951 sur le parvis de la cathédrale. Franco voulut l’interdire en Espagne, et Staline en Russie, pour des raisons différentes. D’autres, plus tard, le dénoncèrent comme une ordure, rebut de la société de consommation vilipendée en 1968. On osa toutes sortes de familiarités et d’audaces. Pierre Perret, pour taquiner les féministes, inventa une Mère Noël, et Boris Vian voulut écrire une vie sexuelle du Père Noël. Puis il renonça. Car il se rendit compte qu’ensuite, il ne pourrait plus croire au Père Noël.
Nous en sommes tous là. Nous avons besoin de lui, même s’il nous récompense un peu vite, sans vraiment distinguer entre ceux qui le méritent et les autres, confondant un peu trop pouvoir d’achat et bons points. Le Père Noël régnera au-delà des rêves des enfants sur une meilleure partie de nous-mêmes, aussi longtemps que nous aurons envie comme eux de courir pieds nus vers la cheminée et de guetter dans leurs yeux l’attente et l’émerveillement.
Christine OCKRENT, Les uns et les autres