Caruso est mort.
Le gouvernement décrète un deuil national. Les drapeaux sont en berne, le roi ouvre la chapelle réservée à la famille royale pour les funérailles et le corps embaumé est exposé dans un sarcophage de verre.
Puccini accuse le coup. Malgré leur quinze ans d’écart et leurs disputes, l’amitié ne s’est jamais démentie. Il appréciait le gamin contraint de travailler dès l’âge de dix ans dans un atelier de mécanique avant que les tarentelles chantées à la terrasse des cafés ne le propulsent sur le devant de la scène. Peu lui importait qu’il ne sache pas déchiffrer une partition. Caruso avait une oreille et une voix en or, il était drôle, simple, les amis de la taverne l’auraient adopté. Avec lui, la conversation était facile et, à défaut d’être originaux, les sujets étaient fondamentaux. Sujet numéro un: la femme ; sujet numéro deux : la santé ; sujet numéro trois : l’argent.
La femme : ils pouvaient établir un parallèle. Puccini connaissait Ada, il les avait recrutés tous les deux pour La Bohème à l’opéra de Livourne, la soprano avait quitté son mari pour le ténor, le mari était entrepreneur, l’aventure lui rappelait sa jeunesse et le représentant en vins et spiritueux largué par Elvira. Par la suite, Caruso veut qu’Ada arrête sa carrière ; elle ne veut pas ; elle refuse de l’accompagner aux États-Unis, quand c’est Puccini qui refuse à Elvira qu’elle accompagne après le suicide de la domestique. Mais il demeure avec Elvira coûte que coûte alors que la femme de Caruso s’en va avec le chauffeur. L’un et l’autre ont des amours passagères, ils en parlent à mots couverts pour ne pas offenser le sort. Caruso rencontre pendant la guerre une jeune Américaine qu’il épouse. Puccini reste pensif et il rigole quand l’autre le traite d’homme à femmes puisque tous les héros de ses œuvres sont des héroïnes.
La santé : ils recommandent l’opium en cas de diarrhée et les Valda pour la gorge irritée par les paquets de cigarettes égyptiennes. Malgré les pastilles, Caruso va de bronchite en laryngite sur fond de migraine et il est opéré d’un nodule sur une corde vocale. Un soir, un élément du décor lui tombe sur le dos ; son médecin diagnostique des douleurs intercostales ; deux mois plus tard, il crache du sang sur scène pendant L’Élixir d’amour ; on découvre une pleurésie compliquée d’un emphysème. Il faut sept opérations pour drainer les humeurs. À côté, le diabète de Puccini ressemble à une promenade de santé, surtout depuis la découverte de l’insuline. Et à propos de gorille*, Caruso lui raconte l’anecdote du zoo de New York, la femme qui l’accuse de lui avoir mis la main au panier, qui appelle un policier ; pour sa défense, il prétend que c’est le gorille qui a eu un geste déplacé, pas de chance, la dame est mariée, on ne plaisante pas avec les mœurs, il est condamné pour outrage à une amende de dix dollars.
L’argent : Ils sont tous les deux en haut de l’échelle, Caruso un peu plus haut car il a enregistré la bagatelle de 260 disques qui en font le premier millionnaire. Ils parlent donc de ponts d’or et de leur équivalent général, les cadeaux à tout va, le soin qu’il met à s’habiller, les grigris, médailles pieuses et corne de corail qui ne le quittent pas, ses collections de timbres, de montres et de tabatières.
Le 1er août, il part consulter un spécialiste à Rome, il meurt le lendemain matin à Naples, où il était né, dans une chambre de l’hôtel Vesuvio, face à la mer, d’une péritonite causée par un abcès au rein.
Puccini ne se rend pas aux funérailles de Caruso.
Bernard CHAMBAZ, Caro, carissimo Puccini
*Puccini aimait se moquer de lui-même en racontant « qu’il avait renoncé à se faire greffer des couilles de gorille à cause de son diabète… »






















 Il est le premier à découvrir Veules en 1857, il est enthousiasmé, et la Normandie devient sa région préférée. En 1870 il fonde et devient président de l’association d’entraide et de bienfaisance des jeunes peintres boursiers russes. A partir de 1874, il conduit ses propres protégés à Veules, c’est ainsi qu’une quinzaine de jeunes peintres partirent découvrir la méthode privilégiant le plein air, la nature et les scènes de la vie quotidienne.
Il est le premier à découvrir Veules en 1857, il est enthousiasmé, et la Normandie devient sa région préférée. En 1870 il fonde et devient président de l’association d’entraide et de bienfaisance des jeunes peintres boursiers russes. A partir de 1874, il conduit ses propres protégés à Veules, c’est ainsi qu’une quinzaine de jeunes peintres partirent découvrir la méthode privilégiant le plein air, la nature et les scènes de la vie quotidienne.


 Sa carrière est fortement influencée par le séjour organisé par Bogolioubov. Se croyant d’abord peintre d’histoire, il découvre à Veules sa vraie vocation de peintre de paysages.
Sa carrière est fortement influencée par le séjour organisé par Bogolioubov. Se croyant d’abord peintre d’histoire, il découvre à Veules sa vraie vocation de peintre de paysages.







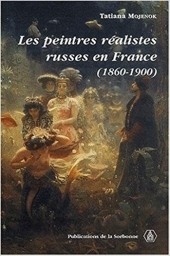


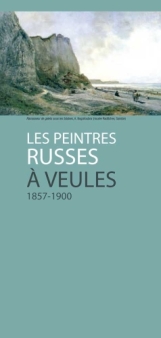
 En 1940, malgré l’absence de port, Veules vit s’embarquer 3000 soldats britanniques et français qui avaient résisté à l’invasion de la France par les Allemands. Beaucoup ne durent leur salut qu’en descendant les falaises d’amont avec des moyens de fortune. En suivit une bataille sanglante, son front de mer fut détruit ainsi que son casino et ses villas (35 maisons sont anéanties le même jour). La « Kommandantur » s’installa à Veules pendant quatre ans, pillant et saccageant d’autres maisons.
En 1940, malgré l’absence de port, Veules vit s’embarquer 3000 soldats britanniques et français qui avaient résisté à l’invasion de la France par les Allemands. Beaucoup ne durent leur salut qu’en descendant les falaises d’amont avec des moyens de fortune. En suivit une bataille sanglante, son front de mer fut détruit ainsi que son casino et ses villas (35 maisons sont anéanties le même jour). La « Kommandantur » s’installa à Veules pendant quatre ans, pillant et saccageant d’autres maisons.










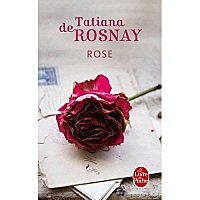
 Patrice de Moncan, incorrigible amoureux de Paris, s’est pris de passion pour l’oeuvre de Marville. Dans une émission de Michel Field (plus visible malheureusement), il explique combien le Second Empire a eu mauvaise presse. Lui en avait la passion, une passion connue de ceux qui, ayant hérité de témoignages de cette époque et connaissant leur peu de valeur marchande, se sont tournés vers lui pour s’en débarrasser, dont L’Album du Vieux-Paris édité par Marville en 1865. Celui-ci était alors un des nombreux photographes de la Ville de Paris, sans gloire particulière de son vivant. Moncan lui a tout d’abord dédié deux expositions et ensuite a fait paraître un livre « Paris avant/après » dans lequel il met en parallèle les clichés de Marville et les siens, puisqu’il a cherché à retrouver les mêmes endroits et à les photographier en 2010 sous le même angle. C’est passionnant et cela réhabilite assez souvent l’oeuvre d’Haussmann.
Patrice de Moncan, incorrigible amoureux de Paris, s’est pris de passion pour l’oeuvre de Marville. Dans une émission de Michel Field (plus visible malheureusement), il explique combien le Second Empire a eu mauvaise presse. Lui en avait la passion, une passion connue de ceux qui, ayant hérité de témoignages de cette époque et connaissant leur peu de valeur marchande, se sont tournés vers lui pour s’en débarrasser, dont L’Album du Vieux-Paris édité par Marville en 1865. Celui-ci était alors un des nombreux photographes de la Ville de Paris, sans gloire particulière de son vivant. Moncan lui a tout d’abord dédié deux expositions et ensuite a fait paraître un livre « Paris avant/après » dans lequel il met en parallèle les clichés de Marville et les siens, puisqu’il a cherché à retrouver les mêmes endroits et à les photographier en 2010 sous le même angle. C’est passionnant et cela réhabilite assez souvent l’oeuvre d’Haussmann.



















