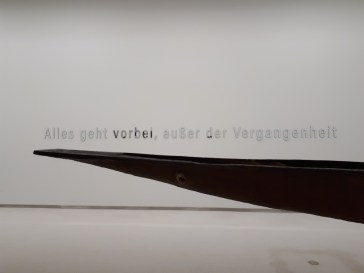Intrépide Parisienne
« Ne crie pas que tu donneras ta vie pour tes principes, pour la vérité ; mais tâche de ne jamais mentir. »
Mi-novembre 1914, Alexandra, le gomchen et leur suite partent passer l’hiver à Lachen. Quand elle se déplace, c’est avec plusieurs caisses, peu d’effets personnels superflus mais une grande bibliothèque d’ouvrages philosophiques dont elle ne peut se passer. Douze yacks portent leurs tentes et bagages. La route est une longue expédition de haute montagne, il leur faut franchir des cols à plus de 5000 mètres d’altitude qui coupent la respiration, subir des tempêtes et des nuits sous la tente où les tempêtes sont rarement positives. Le matin, une lourde neige fait ployer la paroi des tentes de coton. La santé de fer d’Alexandra vacille légèrement : elle attrape froid, endure la fièvre et des douleurs aux oreilles qui auraient fait rebrousser chemin à n’importe quel grimpeur amateur d’aujourd’hui. Le mal disparaît peu à peu. La vaillante orientaliste ne s’est pas plainte un instant, elle rêve devant le paysage qui défile au rythme du pas lent des yacks, admire ses variations de lumière. La majesté de la nature qui l’entoure n’a d’égale que la misère dans laquelle vivent ses habitants.
Lachen est un petit monastère dans les hautes montagnes frontalières du Tibet, à 4500 mètres d’altitude. Alexandra aménage sa propre grotte (…) Elle a un nouveau serviteur, un garçon de quatorze ans à lunettes rondes cerclées d’acier, qui étudie pour devenir lama. Son nom religieux est Nindji Gyatso, mais on l’appelle Aphur Yongden. Né en 1899 dans le Sikkim, sous protectorat britannique depuis 1890, il est à la fois tibétain et sujet de la reine. (…) Qu’est-ce qui a fait que ces deux-là se sont reconnus ? Yongden et Alexandra ne se quitteront plus pendant quarante ans. Il sera son serviteur, son collaborateur, son complice et son ange gardien. Plus tard, elle en fera son fils adoptif.
L’ermitage himalayen durera deux ans. Alexandra rend régulièrement visite au gomchen pour discuter de bouddhisme avec lui. Ils ont conclu un marché : il la fera progresser en tibétain et elle lui apprend l’anglais en retour. De lui, elle tire un enseignement oral inestimable, celui du bouddhisme tantrique. Cette branche à la réputation sulfureuse est basée sur les tantras, textes médiévaux en sanscrit, qui donnent des indications pour la méditation, les rituels et la vie dans son ensemble. Certains adeptes célèbrent le corps, le figures géométriques et la sexualité comme moyen de transcendance, d’où des interprétations fantasmatiques en Occident. Ici aussi, le tantrisme fait peur aux non-initiés. Le tantra, plus haute forme spirituelle du tantrisme tibétain, convoque toutes les énergies au lieu des les annihiler. Les rituels tantriques visent l’illumination en convoquant les chants, la musique, au-delà du simple plaisir esthétique. Après la méditation, le yogi visualise mentalement l’image d’une déité avec des mudras (gestes des mains) et des chants de textes sacrés, dont les mantras, formules dont la répétition doit avoir un effet magique. Le mantra le plus célèbre répète à l’infini « Aum Mani Padme Hum » , les chants peuvent durer plusieurs heures, comme le gyushung a cappella, ou le sadhana qui s’accompagne du tintement des cymbales et de la basse continue des radongs, les longues trompes tibétaines. Les voix de basse des moines, entraînées dès l’enfance, donnent un air d’outre-tombe à ces longues litanies.
En fait de pouvoirs magiques, le gomchen use plutôt de la télépathie ; Alexandra s’y essaiera à son tour et sera témoin de phénomènes particuliers qu’elle rapportera dans le livre Mystiques et magiciens du Tibet. Elle se familiarise aussi avec les us et coutumes tibétains, le climat et la géographie particulière de cette région du monde. (…) Elle prend des photographies saisissantes de Tibétains, leurs visages sombres se détachant de costumes flamboyants. Malgré la fragilité des appareils qu’elle trimbale dans ses bagages, la précarité des développements et la lumière aveuglante de ces altitudes, elle rapportera un grand nombre d’images de très belle qualité en Europe. Elles lui prouveront qu’elle n’avait pas rêvé ces paysages, ces hommes et ces femmes aux traits stupéfiants, aux parures uniques.
Je m’en rends bien compte, il est plus que singulier que, née parisienne, élevée dans une grande ville par des parents qui étaient tout autre chose que des chemineaux ou des poètes, je sois douée de cette mentalité si étrangère à celle de mon milieu. J’ai eu la nostalgie de l’Asie avant d’y avoir jamais été et du premier jour où, il y a bien longtemps, j’ai débarqué en Indochine, je m’y suis sentie chez moi.
Jennifer LESIEUR, Alexandra David-Néel
Un autre destin étonnant lié à l’Himalaya :
















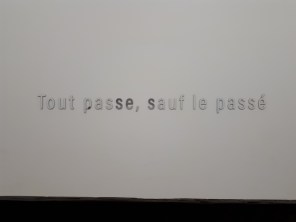



 Le voici par un samedi gelé de janvier 2019, s’étant refait une virginité décolonisatrice, avec adjonction d’une aile d’accueil moderne à l’extrême gauche où je me trouve (avec l’excellent restaurant TEMBO que je vous recommande chaudement). On rejoint le palais-musée par un couloir souterrain plein de surprises.
Le voici par un samedi gelé de janvier 2019, s’étant refait une virginité décolonisatrice, avec adjonction d’une aile d’accueil moderne à l’extrême gauche où je me trouve (avec l’excellent restaurant TEMBO que je vous recommande chaudement). On rejoint le palais-musée par un couloir souterrain plein de surprises.