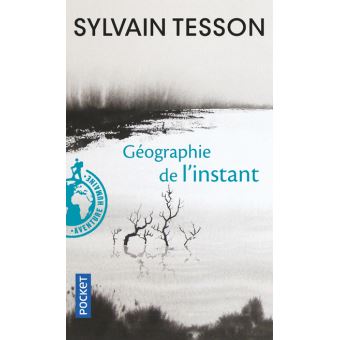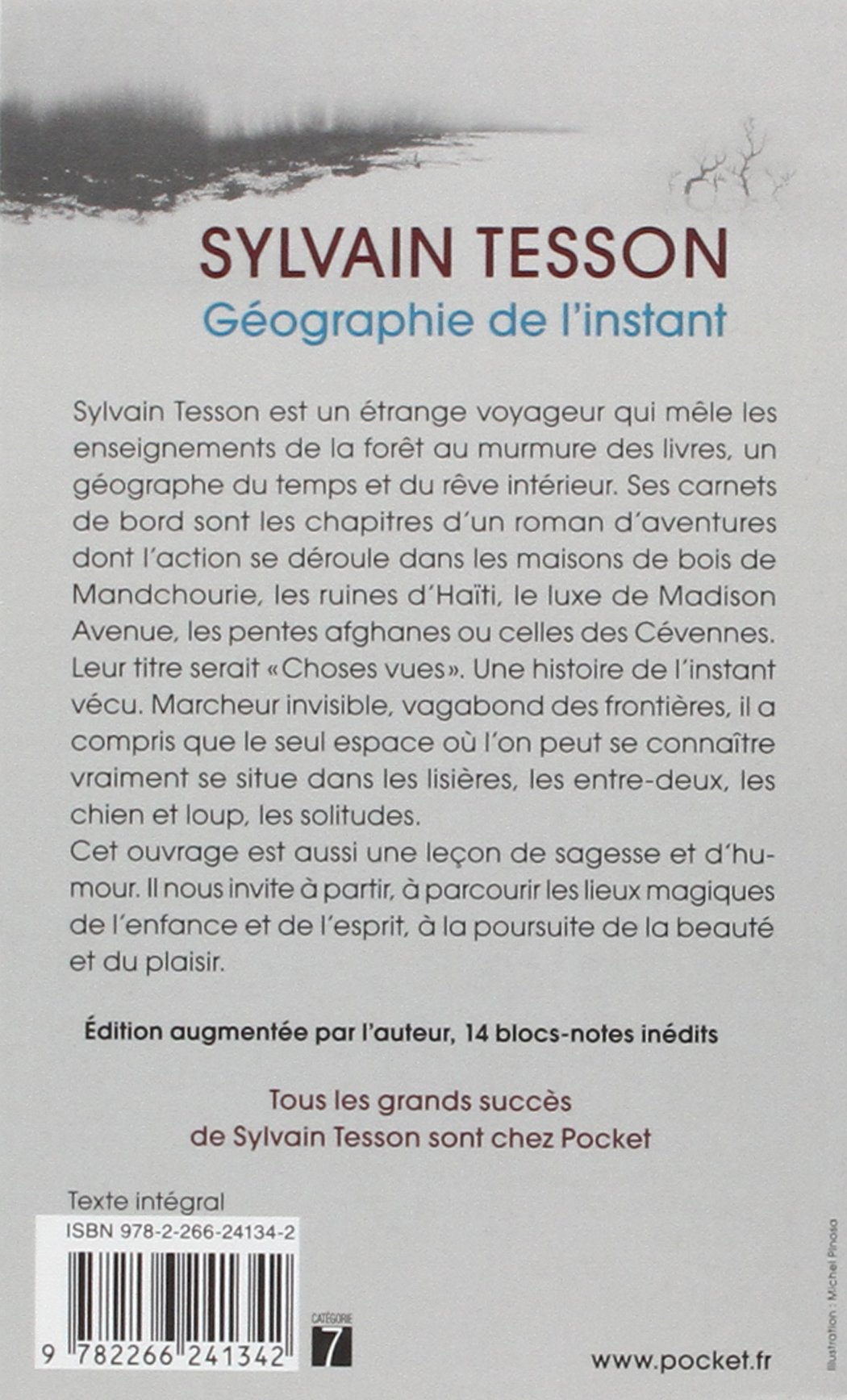Un livre de 1000 pages. Des centaines de lettres, cartes postales ou petits mots griffonnés qui témoignent d’un amour d’un autre temps, d’une étonnante dimension, d’une force (non, pas tranquille!) ; de la vie trépidante également d’un député puis d’un leader politique et enfin d’un président de la République.
Comment préférer un texte plutôt qu’un autre d’autant que François Mitterrand a souvent une plume superbe… Mon parti-pris a été celui de choisir quelques extraits au fil de ces 33 ans de correspondance, qui montrent l’évolution, les crises et la permanence d’une passion.
J’ai refeuilleté entièrement ce gros livre en tous sens, plus de quatre heures de travail mais ce furent des moments très forts, un nouvel éblouissement. Car si on peut ne pas aimer (et même détester) l’homme politique, si on peut lui reprocher cette double vie (ah ! les redresseurs de tort et autres censeurs de la morale!), comment en tant que femme ne pas se dire qu’on aurait aimé recevoir pareille correspondance? Et en tant qu’amoureuse des beaux textes, comment ne pas admirer l’intelligence, la sensibilité, le style littéraire et l’érudition de l’homme? Un Mitterrand inconnu…
Voici un tout petit, mais tout petit panorama. Il en reste des pépites à découvrir dans ce bouquin bouleversant ! Allez-y!
Grand amour
4 novembre 1963
(…) Vous aurez cette lettre dans votre boîte demain mardi. Allez dès l’après-midi chez Ploix, disquaire n°38 rue Saint-Placide (un des meilleurs de Paris). Vous y trouverez un disque que j’ai retenu pour vous, à votre nom, qui s’appelle Trouvères, troubadours et grégorien éditions Studio S.M. Le septième morceau « Alléluia pour la fête de Saint-Joseph » m’a tant ravi, tandis que je l’entendais à travers une terre brulée de soleil, que je n’ai pu résister au plaisir de vous le destiner. Je n’ai pas voulu le déposer chez vous pour n’intriguer personne. Quand vous l’aurez, écoutez aussitôt, je vous en prie, cet « Alléluia ». Je crois que vous aimerez.
Au revoir, Anne. Je ne sais pourquoi je mets dans cette lettre, avec un oeillet Dinde de Lohia et un oeillet des dunes, un peu du parfum de notre première balade aux « Trois-Poteaux ».
À vendredi?
François Mitterrand
∴
Hossegor, samedi 1er août 1964
J’ai voulu bâtir avec toi une vie d’exception.
Par la pensée et par la passion d’aimer, j’ai voulu souder une entente que ni mon âge ni mon état ne m’autorisent à concevoir mais qu’une certitude intérieure (qui me paraît à moi-même stupéfiante, car je reste lucide) me pousse à rechercher. J’ai pourtant longtemps écarté, chassé cette perspective. (…) Confisquer ta vie ! je n’en ai sans doute ni le droit ni le pouvoir. Pourtant bouge en moi une force terrible, pourtant monte en moi un cri de possession et, loin des fièvres et des remords, chaque fois qu’en toi s’accomplit cette pulsation nouvelle d’une vie inconnue qui t’envahit tout entière, s’imprime sur ton visage, et module ton souffle, c’est la paix qui soudain règne dans mon corps et dans mon esprit et m’accorde la splendide harmonie des bonheurs simples. (…) Tu pourras moquer, bafouer, ignorer, délaisser ma tendresse. Tu ne pourras changer cela. Et moi je saurai toute ma vie qu’Anne m’a délivré de moi-même. Par toi, Anne chérie, je communique désormais avec la splendeur des choses créées et, si peu que ce soit, avec la souveraine intelligence du créateur.
François
∴
16 octobre 1967
Mon Anne chérie,
Je ne pouvais plus résister à l’envie que j’avais de te téléphoner et l’annonce de la grève prochaine des P et T a précipité mon appel ! De cette audace j’ai été tellement récompensé que je recommencerai…dès demain. Quelle émotion que ta voix, là, essoufflée, venue droit du verger et colorée d’automne rouge et jaune, comme l’ampélopsis et les forêts de hêtres. Je t’imaginais avec tes bottes, le teint que donne l’air, sain à susciter les baisers sur les joues, le regard vert-bleu des jours d’innocence, la longue démarche pour chemins d’Auvergne, sous le vent, à plein ciel. Je crois bien mon Nanour que je suis amoureux de toi!
François
∴
3 juillet 1970
C’est une vague de fond, mon amour, elle nous emporte, elle nous sépare, je crie, je crie, tu m’entends au travers du fracas, tu m’aimes, je suis désespérément à toi, mais déjà tu ne me vois plus, je ne sais plus où tu es, tout le malheur du monde est en moi, il faudrait mourir mais la mer fait de nous ce qu’elle veut. Oui, je suis désespéré. Le temps reprend souffle et pied? Ô mon amour de vie profonde j’ai pu mesurer un certain ordre des souffrances. ce sera peut-être le seul mot tranquille de cette lettre : je t’aimerai jusqu’à la fin de moi, et si tu as raison de croire en Dieu, jusqu’à la fin des temps. (…)
F
∴
Jeudi 10 février 1972
Tu n’as pas le temps de me voir dans la journée. Je te surprendrai cependant à 15h45 en t’attendant près de ton vélo au Louvre. Une minute de joie intense, tes yeux de lumière, ton étonnement ravi. C’est ça le salut!
∴
Latche, 16 juillet 1973
Mon amour d’Anne,
Je ne suis pas ici depuis assez longtemps pour traverser l’opacité des choses. Mes sens sont en éveil et commencent à percevoir ce qui est le plus saisissable, le plus évident. Quand j’en arriverai au subtil, ou à la connaissance du silence, à l’odeur du vent, aux mutations de la lumière, c’est que je serai sorti de mon habit de ville pour m’intégrer à la nature. (…) Que nous sommes bêtes de nous faire mal quand le temps est si mesuré. (…) J’aimerais écrire pour toi. Tu m’inspires. Ah ! nos randonnées ! Recommençons c’est notre façon de faire notre miel.
ton François
∴
7 janvier 1975
Mazarine chérie,
J’écris pour la première fois ce nom. Je suis intimidé devant ce nouveau personnage sur la terre qui est toi. Tu dors. Tu rêves. Tu vis entre Anne, le veilleur, et ce joli animal qu’on appelle le dormeur. Plus tard, tu me connaîtras. Grandis, mais pas trop vite. Bientôt tu ouvriras les yeux. Quelle surprise, le monde! Tu t’interrogeras jusqu’à la fin sur lui.
Anne est ta maman. Tu verras qu’on ne pouvait pas choisir mieux, toi et moi.
Je t’embrasse
François
∴
24 février 1980, le soir
J’étais si profondément heureux, de vous retrouver ce soir, Mazarine et toi, j’avais le corps, l’esprit, si plein de vous! Je te regardais avec amour et au début avec curiosité et un peu d’inquiétude tant tu t’es retirée en toi-même depuis, ou à peu près, notre retour de Gordes. (…) Comment se parler ainsi? Mais peu importe auprès de cette réalité : te perdre c’est la vie perdue. Imagines-tu, malgré tes colères justes – ou injustes – que depuis quinze ans j’aurais pu connaître avec toi un tel échange si je n’avais été possédé par un amour, un grand amour? (…) Je t’ai fait trop souffrir en ne vivant pas avec toi? Tu ne le supportes plus? De m’avoir trop aimé tu ne peux plus m’aimer? (…) Je ne m’illusionne pas. Cette crise s’ajoute à d’autres et je comprends ta lassitude. C’est trop dur d’être seule pour tant de choses importantes. Je n’ai rien à dire pour me justifier. (..) Je t’ai mal aimée toi que j’aime si fort. Mon Anne (que j’aime écrire ton nom!), Anne, mon Anne.
Demain j’irai au quart square à 12h40, soit avec cinq minutes d’avance. Tu ne pourras pas ou tu ne voudras pas? Je viendrai quand même dans l’attente de toi, qui ne cessera pas. C’est à moi que j’offre la joie de t’attendre le coeur battant. Joie ou chagrin. (…)
Pour terminer une déclaration : je t’aimerai jusqu’à la mort. (…)
François
∴
Paris, le 5 août 1992
L’Anne à qui j’écris n’a jamais cessé d’être pour moi cette jeune fille que j’aimais, il y a vingt-sept ans, à Chênehutte-les-Tuffeaux. Je la vois bleue et or. Bleue comme la Loire, l’horizon et la tapisserie de la chambre, or comme le fond des yeux quand ils s’émerveillent, comme pourrait passer du rose thé au vieil or la rose douce et orgueilleuse de notre premier matin. La rudesse de vivre n’a rien ôté de cette révélation, de cette âme à nu, comme le corps, ni de mon bonheur de t’avoir, enfin, rejointe. Je n’ai pas vu passer les ans, ni les points de repère de l’âge, puisque tu étais là, semblable à toi-même, ma jeune-fille-jeune-femme, devant moi, visage grave et beau sourire, don d’un coeur qui ne se reprend pas.
J’éprouvais à te toucher discrètement cette nuit un bonheur, un étonnement qui n’ont pas pris une ride, une confiance de lac des profondeurs. J’épiais ton réveil. Il n’a été que tendresse, joie d’aimer.
Et si la passion a subi d’autres fièvres, celles de la maladie, de l’usure physique, et se dissimule derrière un quart de siècle et plus d’échanges quotidiens, je sais qu’elle est là, au creux de l’âme, vivante et forte, écho toujours renouvelé des heures d’intensité, tes yeux ouverts perdus dans les miens tandis que s’accomplissaient le rite et le mystère. Je veux aujourd’hui porter témoignage, à toi seule, pour toi seule, mon amour.
J’aime ton nom, ton visage, ton corps, ton coeur, ta voix, tes actes, et j’aime aussi ta fille, qui par-dessus le tout est également la mienne. Nous serons donc l’un près de l’autre ce soir, cette nuit. Je n’aurai pas besoin de te dire autre chose. Toi et moi réunis.
Le rêve nous entraînera dans le secret des choses simples. Il en est une que tu dois savoir, mon Anne de Chênehutte,
c’est que je t’aime
F
∴
Belle-Île, le 22 septembre 1995
(…) Mon bonheur est de penser à toi et de t’aimer.
Tu m’a toujours apporté plus. Tu as été ma chance de vie. Comment ne pas t’aimer davantage?
François
François MITTERRAND, Lettres à Anne • 1962-1995 • Choix





























 Avec un style alerte, une bonne dose d’humour noir et une construction romanesque efficace, Frank Tallis nous immerge dans un monde au bord de l’explosion, « qui danse sur un volcan » mais qui fascine par son bouillonnement intellectuel et artistique, et sa frivolité vénéneuse.
Avec un style alerte, une bonne dose d’humour noir et une construction romanesque efficace, Frank Tallis nous immerge dans un monde au bord de l’explosion, « qui danse sur un volcan » mais qui fascine par son bouillonnement intellectuel et artistique, et sa frivolité vénéneuse. tome allait paraître en anglais au printemps 2018. Le titre est alléchant! *
tome allait paraître en anglais au printemps 2018. Le titre est alléchant! *









 Pour ma part, c’est grâce à l’écrivain Daniel Picouly que je découvris cet étonnant personnage qu’il mit en lumière dans sa triologie de romans La treizième mort du Chevalier , l’Enfant léopard et la suite La nuit de Lampedusa.
Pour ma part, c’est grâce à l’écrivain Daniel Picouly que je découvris cet étonnant personnage qu’il mit en lumière dans sa triologie de romans La treizième mort du Chevalier , l’Enfant léopard et la suite La nuit de Lampedusa.